HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE OCCIDENTALE, par Bertrand Russell, © 1945
---------------------------------------------------------------------------------------
publicité
---------------------------------------------------------------------------------------
III.2.2 : ROUSSEAU
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), bien qu'étant un "philosophe" au sens du XVIIIe siècle français, c'est-à-dire comme appelait ce siècle en France certains de ses penseurs, n'était pas ce que nous appelons de nos jours un philosophe. Néanmoins, il a eu une influence considérable sur la philosophie, aussi bien que sur la littérature, les goûts, les modes de vie et la politique. Quelle que soit notre opinion sur ses mérites en tant qu'intellectuel [c'est le terme apparu fin XIXe pour les penseurs comme Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. qu'on appelait au XVIIIe des "philosophes". Le premier penseur appelé un intellectuel fut -- je crois -- Hugo, à la fin de sa vie], nous devons reconnaître son immense importance comme force sociale.
Cette importance provient essentiellement de son appel au coeur, et à ce qu'on appelait à son époque la "sensibilité". Il est le père du mouvement romantique, l'initiateur de systèmes de pensée qui font dériver des faits non-humains des émotions humaines, et il est l'inventeur de la philosophie politique des dictatures pseudo-démocratiques, par opposition aux monarchies absolues.
[Autrement dit, Rousseau a jeté les bases "philosophiques" du communisme totalitaire, comme Platon l'aurait fait avant lui si un dirigeant d'aventure avait mis en oeuvre la "République" de Platon. Mais Denys de Syracuse, à qui Platon avait rendu visite dans cette vue, n'était pas si fou. Et le seul exemple de régime totalitaire qui ne fût pas une monarchie absolue, dans l'Antiquité, est Sparte, qui justement servit de modèle à Platon, car il était désolé par les désastres amenés par la démocratie athénienne et la guerre du Péloponnèse.]
Depuis l'époque de Rousseau, ceux qui se considéraient comme des réformateurs se partageaient en deux camps : ceux qui suivaient Rousseau, et ceux qui suivaient Locke. Parfois ils coopéraient, et beaucoup d'individus n'y virent aucune incompatibilité. Mais progressivement l'incompatibilité devint flagrante. A l'époque actuelle [les années 30 et 40 du XXe siècle], Hitler est le produit de la pensée de Rousseau ; Roosevelt et Churchill ceux de la pensée de Locke.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Biographie
La biographie de Rousseau a été relatée par lui-même dans ses Confessions en grand détail, mais sans souci excessif pour la vérité. Il aimait se faire passer pour un grand pécheur, et exagérait parfois à cet égard ; mais il y a ample évidence, en dehors de ses propres dires, qu'il était dénué de toutes les vertus ordinaires. Cela ne le troublait pas, car il considérait qu'il avait toujours un grand coeur, qui, cependant, ne l'empêchaient pas des actions les plus odieuses envers ses meilleurs amis. Je me limiterai à la description des aspects de sa vie nécessaires pour comprendre sa pensée et son influence.
Il est né à Genève, et fut élevé dans la stricte orthodoxie calviniste. Son père, qui était pauvre, combinait les professions d'horloger et de maître de danse ; sa mère mourut quand il était en bas âge, et il fut élevé par une tante. Il quitta l'école à l'âge de douze ans, et fut apprenti dans différents métiers, mais les détesta tous, et à l'âge de seize ans [vers 1728] s'enfuit de Genève pour la Savoie.
[la Savoie à cette époque était un territoire faisant partie du Piémont et donc de la galaxie de territoires formant ce qui devint beaucoup plus tard, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Italie du Nord. Techniquement dans les années 1730 c'était une partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Turin était sa capitale, et Chambéry une autre de ses grandes villes.]

La Savoie au XIXe siècle avant son intégration à la France
N'ayant aucun moyen de subsistance, il alla voir un prêtre catholique et lui expliqua qu'il voulait se convertir. La conversion formelle eut lieu à Turin, dans une institution pour catéchumènes ; le processus durait neuf jours. Il présente ses motivations comme purement mercenaires : "Je ne pouvais pas me cacher que l'acte divin que j'accomplissais était à la vérité celui d'un bandit." [traduit vers l'anglais, puis retour vers le français]. Mais il écrivit ceci, beaucoup plus tard, après être retourné au protestantisme, et il y a des raisons de penser que pendant quelques années il fut un catholique de bonne foi. En 1742 il témoigna qu'une maison dans laquelle il vivait dans les années 1730 fut miraculeusement sauvée des flammes par les prières d'un évêque.
Ayant quitté l'institution turinoise avec vingt francs en poche, il devint laquais d'une dame italienne nommée Madame de Vercelli, qui mourut trois mois plus tard. Après sa mort, il fut trouvé en possession d'un ruban ayant appartenu à celle-ci, qu'en fait il avait volé. Il assura que ce rubant lui avait été donné par une certaine servante qui aimait Rousseau ; on le crut et elle fut punie. L'excuse qu'il donna plus tard est étrange : "Jamais la malveillance fut plus éloignée de moi qu'en ce cruel moment ; et quand j'ai accusé la pauvre fille, cela semble une contradiction ; cependant je dois à la vérité de dire que c'est mon affection pour elle qui est la cause de ce que j'ai fait. Elle était présente à mon esprit, et j'ai jeté le blâme sur le premier objet qui s'est présenté à moi." Ceci est un bon exemple de la façon dont, dans l'éthique de Rousseau, la "sensibilité" remplaçait les vertus ordinaires.
Après cet incident, Madame de Warens lui manifesta de l'amitié ; elle s'était, comme Rousseau, convertie du protestantisme au catholicisme ; cette dame charmante jouissait d'une pension versée par le roi de Savoie en considération de ses services pour la religion. Pendant une dizaine d'années, Rousseau passa le plus clair de son temps dans sa maison ; il l'appelait "maman" même après qu'elle fut devenue sa maîtresse. Pendant une période il partageait Mme de Warens avec le factotum de la maison ; la meilleure entente régnait entre les trois, et quand le factotum mourut Rousseau éprouva de la tristesse, mais il se consola en pensant : "Eh bien, je recevrai ses vêtements."
Durant ses jeunes années il y eut diverses périodes qu'il passa en tant que vagabond, voyageant à pied, et trouvant ses précaires moyens de vivre comme il pouvait. Durant un de ces interludes, un ami, avec lequel Rousseau voyageait, eut une crise d'épilepsie dans la rue à Lyon ; Rousseau profita de la foule assemblée autour du malheureux pour abandonner son ami au milieu de sa crise. En une autre occasion il devint le secrétaire d'un homme qui se présentait comme un archimandrite se rendant au Saint Sépulcre ; en une autre encore, il eut une affaire avec une femme riche, en se faisant passer pour un Ecossais jacobite [partisan des Stuart] nommé Dudding.
Cependant, en 1743 [à l'âge de 31 ans], par l'entremise d'une dame de la haute société, il devint le secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, un sot nommé Montaigu, qui laissa tout le travail à Rousseau mais négligea de lui verser son salaire. Rousseau s'acquitta correctement de sa tâche, et l'inévitable querelle qui s'ensuivit ne fut pas de sa faute. Les vexations liées à ce retard de paiement ont quelque chose à voir avec l'animosité qu'éprouva toujours Rousseau contre le gouvernement français, bien qu'il finît par recevoir tous les arriérés de salaire qui lui étaient dus.
Cinq enfants, tous abandonnés à l'Assistance publique
C'est vers cette époque (1745) qu'il démarra une relation avec Thérèse Levasseur, une femme de chambre dans l'hôtel où habitait Rousseau à Paris. Il vécut avec elle le restant de ses jours (sans exclure d'autres relations) ; il eut d'elle cinq enfants, qu'il abandonna tous à l'Assistance publique.
Personne n'a jamais compris ce qui l'attirait vers cette femme de chambre. Elle était laide et sans instruction ; elle ne savait ni lire ni écrire (il lui apprit à écrire, mais pas à lire) ; elle ne connaissait pas les noms des mois, et ne savait pas additionner ou compter la monnaie. La mère de Thérèse était accapareuse et avare ; la mère et la fille utilisèrent Rousseau et tous ses amis comme sources de revenus. Rousseau affirme (ce qui est peut-être vrai, peut-être faux) qu'il n'a jamais éprouvé une once d'amour pour Thérèse ; plus tard dans leur vie commune elle se mit à boire, et elle eut des affaires avec des garçons d'écurie. Probablement, il aimait le sentiment de se sentir supérieur à elle, aussi bien financièrement qu'intellectuellement, et il aimait qu'elle soit totalement dépendante de lui.
Il éprouva toujours une sorte de gêne en présence de personnes socialement élevées ou puissantes, et préférait réellement la compagnie des petites gens ; à cet égard son sentiment démocratique était authentique. Bien qu'il ne se mariât jamais, il traita Thérèse Levasseur presque comme sa femme, et toutes les grandes dames qui portèrent de l'amitié à Rousseau durent la supporter.
Premier succès littéraire. Essai sur la question : "Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs ?"
Son premier succès littéraire arriva relativement tard dans sa vie. L'Académie de Dijon avait lancé un prix pour le meilleur essai sur la question : Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs ? Rousseau envoya un essai dans lequel il répondait par la négative et il remporta le premier prix en 1750 [à l'âge de 38 ans].
Il soutenait que la science, la littérature, et les arts sont les pires ennemis de la morale, et, en créant des besoins, ils sont les sources de l'esclavage ; car comment des chaînes pourraient-elles entraver ceux qui vivent dans le dénuement, comme les sauvages d'Amérique ?
Comme on peut s'y attendre, il est pour Sparte contre Athènes. Il avait lu Les Vies de Plutarque à l'âge de sept ans, et avait été fortement influencé par cet ouvrage ; il admirait tout particulièrement la vie de Lycurgue. Comme les Spartiates, il considérait la victoire à la guerre comme le test du mérite ; néanmoins, il admirait le "noble sauvage", que les Européens sophistiqués avaient battu à la guerre. La science et la vertu, soutenait-il, sont incompatibles, et toutes les sciences ont une origine ignoble [= basse, repoussante]. L'astronomie vient des superstitions de l'astrologie ; l'éloquence vient de l'ambition ; la géométrie de l'avarice ; la physique est une curiosité vaine ; et même l'éthique trouve sa source dans l'orgueil humain. L'instruction et l'imprimerie sont à déplorer ; tout ce qui distingue l'homme civilisé du barbare sans instruction est néfaste.
Ayant remporté le prix et atteint soudainement la célébrité grâce à son essai, Rousseau se mit à vivre selon ses maximes. Il adopta un mode de vie simple, vendit sa montre, déclarant qu'il n'avait plus besoin de savoir l'heure.
Discours sur l'Inégalité
Les idées exposées dans le premier essai furent développées de manière plus élaborée dans un second essai, intitulé "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" (1754), qui, cependant, ne reporta pas de prix. Il soutenait que "l'homme est naturellement bon, et que ce sont les institutions qui le rendent mauvais" -- l'antithèse de la doctrine du péché originel et du salut grâce à l'Eglise. Comme tous les théoriciens de son époque, il parlait d'un état de nature, bien que quelque peu hypothétique, comme d'un "état qui n'existe plus, peut-être n'a jamais existé, probablement n'existera jamais, mais sur lequel néanmoins il est nécessaire d'avoir des idées justes, afin de juger correctement notre état actuel". La loi naturelle doit être déduite de l'état de nature, mais tant que nous serons ignorants de l'homme naturel il sera impossible de déterminer la loi prescrite à l'origine ou qui lui est le mieux adaptée. Tout ce que nous pouvons savoir est que les volontés de ceux sur lesquels elle s'applique doivent être conscients de leur soumission, et cela doit venir directement de la voix de la nature. Il ne remet pas en question les inégalités naturelles, en matière d'âge, de santé, d'intelligence, etc., mais seulement les inégalités résultant de privilèges autorisés par les conventions.
L'origine de la société civile et des inégalités sociales qui en résultent se trouvent dans la propriété privée. "Le premier homme qui ayant enclos un terrain, déclara "ceci est à moi", et trouva des gens suffisamment simples d'esprit pour le croire, est réellement le fondateur de la société civile." Rousseau poursuit en disant qu'une révolution déplorable introduisit la métallurgie et l'agriculture ; les grains [produits par l'agriculture] sont le symbole de notre infortune. L'Europe est le continent le plus malheureux, car il a le plus de grain et le plus de fer. Pour défaire ce malheur, il faut seulement abandonner la civilisation, car l'homme est naturellement bon, et l'homme sauvage, quand il a dîné, est en paix avec la nature et l'ami de toues les créatures (mes italiques).
Relations avec Voltaire : admiration puis haine
Rousseau envoya son essai à Voltaire, qui répondit (1755) : "J'ai reçu votre nouveau livre contre l'espèce humaine, et je vous en remercie. Jamais autant d'intelligence ne fut utilisée dans le but de nous rendre tous stupides. On se prend à regretter, en lisant votre livre, de ne plus marcher à quatre pattes. Mais comme j'ai perdu cette habitude il y a plus de soixante, je crois malheureusement impossible de la reprendre. Je ne peux pas non plus me mettre en quête des sauvages du Canada, parce que les problèmes de santé dont je souffre exigent la présence d'un médecin non loin de moi ; parce que ces régions sont en guerre ; et parce que l'exemple de nos actions a rendu ces sauvages presque aussi mauvais que nous."
Il n'est pas surprenant que Rousseau et Voltaire finirent par se fâcher ; l'extraordinaire est que cela n'arriva pas plus vite.
Citoyen de Genève
En 1754, Rousseau étant devenu célèbre, sa ville natale se souvint de lui, et l'invita à venir à Genève. Il accepta, mais comme seuls les calvinistes pouvaient être citoyens de Genève, il se reconvertit à sa foi d'origine. Il avait déjà adopté l'habitude de parler de lui-même comme d'un Genevoix puritain et républicain, et après sa reconversion il songea à vivre à nouveau à Genève. Il dédia son Discours sur l'Inégalité à la République de Genève et à ses "magnifiques, très honorés et souverains seigneurs", mais cela ne leur plut pas ; ils n'avaient aucun désir d'être considérés comme seulement les égaux des citoyens ordinaires. Leur opposition ne fut pas la seule difficulté de sa vie à Genève ; il y en eut une autre, plus grave : c'était que Voltaire était venu vivre juste à côté. Voltaire était un auteur de pièces, et un enthousiaste du théâtre, mais Genève, pour des raisons de puritanisme, interdisait toute représentation dramatique. Quand Voltaire tenta de faire annuler l'interdiction, Rousseau se rangea du côté des puritains. Les sauvages ne jouent pas de pièce de théâtre ; Platon les désapprouvait ; l'Eglise catholique refusait de marier ou d'enterrer les comédiens ; Bossuet appelait les pièces de théâtre "l'école de la concupiscence". L'occasion d'une attaque contre Voltaire était trop bonne pour ne pas la saisir, et Rousseau se fit le champion de la vertu ascétique.
Opinion sur le remblement de terre de Lisbonne
Ce ne fut pas le premier désaccord public entre les deux hommes. Le premier concerna le tremblement de terre de Lisbonne (1755), à propos duquel Voltaire écrivit un poème jeta le doute sur le gouvernement du monde par la Providence. Rousseau fut indigné. Il fit le commentaire suivant : "Voltaire, tout en donnant l'impression de toujours croire en Dieu, n'a jamais vraiment cru qu'au Diable, puisque son prétendu Dieu est un Etre malfaisant qui, selon Voltaire, trouve son plaisir en faisant le mal. L'absurdité de cette doctrine est particulièrement révoltante chez un homme loué pour de nombreuses bonnes choses, et qui, au milieu de son propre bonheur, cherche à remplir ses semblables de désespoir, pas la cruelle et terrible représentation des graves calamités dont il est lui-même épargné."
[Rousseau était un de ces excités, gourous, ne pratiquant pas dans leur vie privée la morale qu'ils voulaient imposer aux autres, comme Saint Augustin. Comme ce dernier aussi, Rousseau a eu une profonde influence sur un régime totalitaire : Augustin --> Eglise catholique ; Rousseau --> communisme.]
Rousseau, quant à lui, ne vit pas dans ce tremblement de terre de quoi nourir une polémique. Il est bon qu'un certain nombre de gens soit tués de temps à autre. En outre, les habitants de Lisbonne souffraient car ils vivaient dans des maisons ayant jusqu'à six étages ; s'ils s'étaient égayés dans les bois, comme les gens devraient faire, ils auraient échappé aux blessures.
Les questions sur le théologie des tremblements de terre et la moralité des pièces de théâtre entraîna une vive inimitié entre Voltaire et Rousseau, dans laquelle tous les philosophies choisirent leur camp. Voltaire traita Rousseau de fou malfaisant ; Rousseau parla de Voltaire comme de "ce hérault de l'impiété, ce grand génie, mais cette âme basse". Les bons sentiments, cependant, doivent trouver leur expression, et Rousseau écrivit à Voltaire (1760) : "Je vous déteste, en fait, car vous l'avez voulu ; mais je vous déteste comme un homme qui vous aurait aimé si vous l'aviez accepté [la psychologie de Rousseau rappelle la psychologie féminine : dans quelles circonstances une femme déteste-t-elle très fort un homme ?]. De tous les sentiments dont mon coeur est rempli pour vous, il ne reste que l'admiration, que vous ne pouvez pas refuser, pour votre grand génie, et l'amour de vos écrits. S'il n'y a rien d'autre en vous que je puisse honorer, à part vos talents, ce n'est pas de ma faute."
La nouvelle Héloïse, Emile (traité sur l'éducation des enfants), et Le contrat social
Nous arrivons maintenant à la période la plus fructueuse de la vie de Rousseau. Son roman La nouvelle Héloïse parut en 1760 ; Emile et le Contrat social tous deux en 1762. Emile, qui est un traité sur l'éducation selon les principes "naturels", aurait pu être considéré comme inoffensif par les autorités s'il n'avait pas contenu "La Profession de foi du vicaire savoyard", qui présentait les principes de la religion naturelle telle que la comprenait Rousseau, et était irritant pour l'orthodoxie catholique autant que protestante. Le Contrat social était encore plus dangereux, car il était partisan de la démocratie et refusait d'admettre le droit divin des rois. Les deux livres, tout en accroissant encore considérablement sa célébrité, attirèrent sur lui une tempête de condamnations officielles. Il fut contraint de fuir la France ; Genève ne voulait rien entendre non plus de ses thèses. (Le Concile de Genève ordonna que ses deux livres fussent brûlés, et donnèrent des ordres pour que Rousseau fût arrêté s'il venait à Genève. Le gouvernement français avait ordonné son arrestation ; la Sorbonne et le Parlement de Paris condamnèrent Emile.) Berne refusa de lui accorder l'asile. Finalement Frédérick le Grand le prit en pitié, et l'autorisa à vivre à Motiers, près de Neuchâtel, qui faisait partie des territoires du roi-philosophe. Rousseau y vécut trois années ; mais à la fin (1765) les villageois de Motiers, conduits par le pasteur, l'accusèrent d'empoisonnement et tentèrent de l'assassiner. Il s'enfuit en Angleterre, où Hume, en 1762, avait offert ses services.
Fuite en Angleterre, fin misérable en France
En Angleterre, au début, tout se passa bien. Il avait beaucoup de succès social, et George III lui accorda une pension. Il vit Burke presque quotidiennement, mais leur amitié se refroidit rapidement au point que Burke déclara : "Il n'a aucun principe, que ce soit pour influencer son coeur, ou pour guider son esprit, autre que la vanité." Hume resta fidèle le plus longtemps de tous, disant qu'il aimait beaucoup Rousseau, et qu'il pourrait vivre toute sa vie en éprouvant de l'amitié et de l'estime mutuelles. Mais à ce moment-là Rousseau -- cela peut se comprendre -- avait commencé à souffrir de la maladie de la persécution qui finit par le rendre fou ; et il soupçonnait Hume d'être un agent de complots voulant attenter à sa vie. Dans des éclairs de lucidité il se rendait compte de l'absurdité de tels soupçons, et embrassait Hume, en s'exclamant : "Non, non, Hume n'est pas un traître", ce à quoi, certainement embarrassé, Hume répondait : "Quoi, mon cher Monsieur !" Mais à la fin les délires de Rousseau l'emportèrent et il s'enfuit. Il passa ses dernières années à Paris dans une grande pauvreté, et quand il mourut certains pensèrent à un suicide.
Après leur rupture, Hume dit de Rousseau : "Il n'a jamais que ressenti [par opposition à réfléchi] durant toute sa vie, et à cet égard sa sensibilité était à un degré au-delà de ce que j'ai jamais rencontré chez qui que ce soit d'autre ; mais cela lui donnait un sentiment plus aigu de la peine que du plaisir. Il était non seulement comme un homme dépouillé de ses vêtements, mais même comme un écorché, et, dans cet état, il combattit tout les éléments rudes et turbulents."
Cette phrase de Hume est le résumé le plus gentil que l'on puisse faire du caractère de Rousseau qui soit un tant soit peu compatible avec la vérité.
Importance des ouvrages de Rousseau, prééminence des émotions et du coeur, sur la raison et la réflexion
Il y a beaucoup de choses dans les ouvrages de Rousseau qui, quelle que soit leur importance à d'autres égards, ne concernent pas l'histoire de la pensée philosophique. Il n'y a que deux parties dans ses réflexions que je vais considérer en détail ; ce sont, d'abord, sa théologie, ensuite, sa théorie politique.
Théologie : pas besoin de raisonnements
En théologie il apporta une innovation que a maintenant été acceptée par la grande majorité des théologiens protestants. Avant Rousseau, tout philosophe depuis Platon, s'il croyait en Dieu, offrait des arguments intellectuels en faveur de cette croyance. (Nous devons faire une exception pour Pascal. "Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas" est tout à fait dans le style ultérieur de Rousseau.) Les arguments de Rousseau [qui vont être fondés sur les "convictions du coeur" et non de l'esprit] peuvent, à nous, ne pas sembler très convaincants. Et nous pouvons penser qu'ils n'auraient pas semblé avoir la moindre force à quiconque n'aurait pas déjà était convaincu de leurs conclusions. Mais le philosophe qui avance de tels arguments certainement croit qu'ils sont logiquement valides, et qu'ils sont à même d'entraîner la croyance en l'existence de Dieu chez n'importe quelle personne n'ayant pas d'a priori et étant capable de suivre des arguments philosophiques. Les protestants modernes qui nous enjoignent de croire en Dieu, pour la plupart, exècrent les vielles "preuves" de l'existence de Dieu [de Saint Anselme à Leibniz], et fondent leur foi sur certains aspects de la nature humaine -- le sentiment d'émerveillement et de mystère devant la contemplation de l'univers, le sens du bien et du mal, le sentiment que nous pouvons nous améliorer, etc.
[Il l'agit en fait d'un mélange anodin de mythes bibliques (la création), orientaux (le bien et le mal), et grecs (la conscience responsable), de stoïcisme et de théologie première manière, à la Plotin, mais sans le côté morbide et coercitif introduit plus tard par les catholiques.
Les catholiques étaient finalement les plus logiques, si l'on considère -- comme Durkheim (et comme le traducteur) -- qu'une religion est avant tout une structure et un instrument social pour faire fonctionner une société.
Dans le monde occidental moderne déchristianisé, la religion a été remplacée par la télévision, et pour les plus mous du bulbe par les diverses sectes comme les témoins de Jéhovah qui font, en couple, la femme en jupe, le pied de grue tous les matins dans le froid avec leur panneau de dépliants publicitaires, à côté de chez moi devant la mer où ne passe personne. Mais les techniques de manipulation des masses n'ont pas essentiellement changé.]
Cette façon de défendre les croyances religieuses a été inventée par Rousseau. C'est devenu si commun aujourd'hui que son originalité peut ne pas être appréciée à sa juste valeur par un lecteur moderne, sauf s'il prend la peine de comparer Rousseau à, mettons, Descartes ou Leibniz.
Croyance en Dieu de Roussseau
"Ah, Madame !, écrivit Rousseau à une dame de l'aristocratie, parfois dans le silence de mon cabinet, les mains pressées sur mes yeux ou dans l'obscurité de la nuit, j'incline à penser qu'il n'y a pas de Dieu. Mais regardez au-delà : le lever du soleil, quand il disperse les brumes recouvrant le terre, et révèle la merveilleuse scène de la nature, disperse en même temps tous les nuages dans mon âme. Je retrouve la foi, et mon Diu et ma croyance en lui. Je l'admire et l'adore, et me prosterne en sa présence."
Un autre fois il dit : "Je crois en Dieu avec autant de conviction que je crois en n'importe quelle autre vérité, parce que croire et ne pas croire sont les dernières choses dans ce monde qui dépendent de moi."
[Le souci des écrivains de cette époque de faire des phrases emphatiques, pour de donner de la solennité à leur propos, a pour conséquence que parfois elles veulent dire tout et son contraire -- croire en Dieu dépend de Rousseau ou ne dépend pas de Rousseau ? "dernières" peut vouloir dire "les ultimes qui restent" ou bien "les plus éloignées de la série" -- ; mais peu importe car de toute façon les idées qu'elles veulent exprimer sont sans consistance.]
Cette forme d'argumentation a le défaut d'être privé ; le fait que Rousseau ne peut pas ne pas croire à quelque chose n'offre aucune base à qui que ce soit pour croire la même chose.
Rousseau était très emphatique dans son théisme. En une occasion il menaça de quitter un dîner parce que Saint Lambert (l'un des invités) exprimait des doutes sur l'existence de Dieu. "Moi, Monsieur, s'exclama Rousseau avec colère, je crois en Dieu !" Robespierre, en toutes choses le fidèle disciple de Rousseau, le suivait aussi dans ce domaine. La "Fête de l'Etre suprême" aurait eu la totale approbation de Rousseau.
"La Profession de foi du vicaire savoyard"
"La Profession de foi du vicaire savoyard" qui est un interlude dans le quatrième livre d'Emile, est la plus explicite et la plus formelle des proclamations de la croyance de Rousseau. Bien qu'il professe que ce soit ce que la voix de la nature a déclaré à un prêtre vertueux, qui souffre de disgrâce pour avoir commis la faute tout à fait "naturelle" d'avoir séduit une femme non mariée" ("Un prêtre en bonne règle ne doit faire des enfants qu'aux femmes mariées", rapporte ailleurs Rousseau comme un dicton exprimé par un prêtre savoyard), le lecteur découvre avec surprise que la voix de la nature, quand elle commence à parler, profère un salmigondis d'arguments dérivés d'Aristote, Saint-Augustin, Descartes, etc. Il est vrai qu'ils sont dépouillés de toute précision et forme logique ; cela est supposé les excuser, et permettre au vicaire si admirable de dire qu'il ne se soucie pas de la sagesse des philosophes.
Les parties suivantes de la "Profession de foi" rappellent moins les penseurs qui ont précédé Rousseau que les premières parties. Après s'être convaincu à sa satisfaction qu'il y a un Dieu, le vicaire continue en considérant les règles de conduite. "Je ne déduis pas ces règles, dit-il, des principes de la haute philosophie, mais les trouve dans les profondeurs de mon coeur, écrites par la Nature en lettres ineffaçables." A partir de là, il développe l'idée que la conscience en toute circonstance est un guide infaillible vers ce qu'il est bon de faire.
[Platon déjà déclarait que l'homme sait en toute circonstance ce qui est le bien.]
"Grâce en soit rendue aux Cieux, conclut-il cette partie de son argumentation, car nous sommes ainsi délivrés de tout l'effrayant appareil de la philosophie ; nous pouvons être humains sans être instruits ; dispensés de devoir perdre notre vie à étudier la morale, nous avons pour un moindre prix un guide plus assuré dans cet immense labyrinthe des opinions humaines."
Nos sentiments naturels, maintient-il, nous conduisent à servir l'intérêt commun, tandis que notre raison nous encourage à être égoïstes. Il nous suffit donc de suivre nos sentiments plutôt que notre raison pour être vertueux.
[Rousseau ne fait pas exception parmi les "penseurs" maîtres à penser: il propose lui aussi, de manière très directive, un mode de vie qui, dit-il, nous conduira à la vertu. Il est proche de Platon, des stoïciens (pour qui la vertu est plus importante encore que la bonne action), et de Saint Augustin. Ce qui est frappant, c'est que, comme tous les gourous, il est imprécateur, se met facilement en colère, et ne vit pas lui-même selon les principes qu'il professe. Cf. l'opinion du Whig néanmoins très conservateur Edmund Burke, 1729-1797, qui déclara que Rousseau n'avait principe autre que la vanité.]
Pas besoin de Révélation
La religion naturelle, comme le vicaire appelle sa doctrine, n'a pas besoin d'une Révélation ; si les hommes avaient écouté ce que Dieu disait à leur coeur, il n'y aurait eu qu'une seule religion dans le monde entier. Si Dieu s'est révélé à certains hommes, cela ne peut être connu que par des témoignages humains, qui sont toujours faillibles. La religion naturelle présente l'avantage d'être révélée directement à chacun individu.
Il y a un curieux passage sur l'Enfer. Le vicaire ne sait pas si le mauvais ira vers les tourments éternels, et déclare, de manière quelque peu hautaine, que le sort du mauvais ne l'intéresse pas beaucoup ; mais dans l'ensemble il incline à penser que les souffrances de l'Enfer ne durent pas indéfiniment. Quoi qu'il en soit, il est sûr que le Salut n'est pas réservé aux membres d'une seule Eglise.
[Evidemment cela décrit un Dieu dont la position est plus ouverte et tolérante, que celle du Dieu des calvinistes. Mais ça n'en est pas moins des délires métaphysico-théologiques sur ce que Dieu veut et ne veut pas, a prévu et pas prévu.
Rousseau, comme la plupart des philosophes depuis les présocratiques, cherche des arguments convaincants et indiscutables pour dire comment vivre, individuellement et en société. Il refuse une religion trop coercitive, déclare qu'on sait chacun au fond de son coeur comment il faut vivre, ne vit pas comme cela lui-même (à part qu'il a vendu sa montre), et déclare qu'il a la preuve qu'il y a un Dieu, "puisqu'il en est sûr".
C'est un agité, à l'intelligence manifestement supérieure mais brouillonne, qui alterne entre la bienveillance des épicuriens et les imprécations de Saint Augustin, en étant généralement plus près de ce dernier.
Mais il a fondé une école de pensée -- "contentez-vous de lire dans votre coeur" -- qui a fourni les arguments à des totalitarismes encore pire que l'Eglise catholique.
En effet, quand on "lit dans son coeur" on découvre en général qu'on se sent supérieur aux autres. C'est un sentiment naturel, et peut-être nécessaire pour s'occuper de soi-même, mais il faut le prendre avec un grain de sel, sinon la vie en société deviendrait impossible.
Le problème du totalitarisme nazi, en particulier, est qu'il a invité chacun de ses membres à se croire faisant partie d'une race supérieure, avec les conséquences qu'on a vues. Il est vrai malheureusement que certaines de leurs victimes avaient le même sentiment de leur propre supériorité, peuple élu, choisi par Dieu, et beaucoup de celles qui ont survécu l'ont encore.]
C'est vraisemblablement le rejet de la révélation et de l'Enfer qui choqua si profondément le gouvernement français et le Conseil de Genève.
Conséquences du rejet de la raison en faveur du coeur
Le rejet de la raison en faveur du coeur n'était pas, à mon avis, un progrès. En fait, personne n'avait pensé à ce stratagème [pour démontrer Dieu] tant que la raison était apparue être du côté de le croyance religieuse.
A l'époque et dans l'environnement intellectuel de Rousseau, la raison, représentée par Voltaire, était opposée à la religion, par conséquent Rousseau déclare : "débarrassez-nous de la raison !"
[A l'inverse Voltaire fut saisit par une indignation violente contre la religion dans l'affaire Calas, et écrivit une défense très vigoureuse de la raison par rapport à la religion.]
En outre, la raison était parfois abstruse et difficile ; le sauvage, même quand il a dîné, ne peut pas comprendre l'argument ontologique, et pourtant le sauvage est le dépositaire de toute la sagesse nécessaire et suffisante. Le "bon sauvage" de Rousseau -- qui était différent du sauvage que connaissaient les anthropologues -- était un bon mari et un bon père, il était dénué d'avidité, et avait une religion de gentillesse naturelle. C'était une personne commode, mais, s'il pouvait suivre les raisons du bon vicaire pour croire en Dieu, il devait avoir davantage de philosophie que son innocente naïveté nous conduirait à attendre de lui.
"L'homme dans l'état de nature"
Outre le caractère fictif de "l'homme dans l'état de nature" de Rousseau, il y a deux autres objections à la pratique consistant à fonder ses croyances relatives à des faits objectifs sur les émotions et sur le coeur. L'une est qu'il n'y a aucune raison de supposer que de telles croyances seront vraies ; l'autre est que les croyances qui en résultent seront de nature individuelle et privée, puisque le coeur dit des choses différentes à des personnes différentes. Certains sauvages sont persuadés par leur "lumières naturelles" que c'est leur devoir de manger les gens, et même les sauvages de Voltaire, qui sont conduits par la voix de la raison à soutenir qu'il ne faut manger que les Jésuites, ne sont pas totalement satisfaisants. Aux bouddhistes, les lumières de la nature ne révèlent pas l'existence de Dieu, mais proclament que c'est une faute de manger la chair des animaux. Mais même si le coeur disait la même chose à tous les hommes, cela ne serait pas une preuve de l'existence ou la véracité de cette chose en dehors de nos émotions. Quelle que soit l'ardeur avec laquelle moi, ou toute l'humanité, désirons quelque chose, quel que soit son caractère nécessaire pour le bonheur des hommes, cela ne prouve pas que ça existe.
[De temps en temps, R. se met à enfoncer des portes ouvertes, comme dans son ouvrage "Pourquoi je ne suis pas chrétien" qui est tellement simpliste que je soupçonne qu'il a fait du tort à sa propre cause.
Et l'on se dit que la "philosophie analytique", qui se prétend rigoureuse, doit être de la même farine.]
Il n'y a pas de loi de la nature qui garantisse que l'humanité devrait être heureuse. Tout le monde peut voir que c'est vrai dans notre propre vie ici-bas, mais par un curieux artifice nos propres souffrances dans cette vie sont transformées en argument pour expliquer que la vie sera meilleure dans l'au-delà. Nous ne devrions pas employer un tel argument dans quelque situation que ce soit. Si vous avez acheté dix douzaines d'oeufs à quelqu'un, et la première douzaine est pourrie, vous ne déduiriez pas automatiquement que les neuf autres douzaines seront sans doute excellentes [pour contrebalancer la première] ; cependant c'est le genre de raisonnement que "le coeur" encourage à suivre pour nous consoler de nos souffrances ici-bas.
Pour ma part, je préfère l'argument ontologique, l'argument cosmologique, et les autres produits que la scolastique avait en magasin, à l'illogisme sentimental de Rousseau. Les vieux arguments avaient au moins le mérite d'être honnêtes : s'ils étaient valides, ils prouvaient leur point ; s'ils étaient invalides, il était loisible à tout critique de le montrer. Mais la nouvelle théologie du coeur se dispense de tels arguments ; elle ne peut pas être réfutée, parce qu'elle ne prétend pas prouver ce qu'elle déclare [elle l'assène avec des arguments comme "eh j'en suis convaincu, car je le ressens très fort au fond de mon coeur"].
Au fond, la seule raison avancée pour que nous acceptions ce qu'elle dit est qu'elle nous permet de nous complaire dans d'agréables rêves. C'est une raison sans valeur, et si j'avais à choisir entre Thomas d'Aquin et Rousseau je choisirais sans hésiter le saint.
Le contrat social (1762)
La théorie politique de Rousseau est présentée dans son Contrat social, publié en 1762. Ce livre a un caractère très différent de ses autres livres ; il y a peu de sentimentalisme, et beaucoup de raisonnement intellectuel serré. Ses doctrines, bien qu'elles semblent formellement rendre hommage à la démocratie, tendent à justifier l'Etat totalitaire.
[La même chose pouvait être dite de la République de Platon, mais chez Rousseau c'est plus subtil, car au lieu d'attribuer le pouvoir aux philosophes et aux gardiens, il l'attribue au "peuple souverain" qui met en oeuvre la "volonté générale".]
Mais la combinaison de Genève et l'Antiquité lui faisait préférer la cité-Etat aux grands empires comme ceux de la France ou de l'Angleterre. Sur la page de titre, il se déclare "citoyen de Genève", et dans les mots préliminaires du premier chapitre il dit : "Né citoyen d'un Etat libre, et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire."
Il y a de fréquentes références laudatives à Sparte, provenant de la vie de Lycurgues par Plutarque [on se rappelle que Lycurgue est un personnage mythique, à la façon de Romulus et Remus, qui aurait fondé le régime politique de Sparte]. Rousseau dit que la démocratie fonctionne le mieux dans de petits Etats, l'aristocratie dans des Etats de taille moyenne, et la monarchie dans de grands Etats. Mais il faut comprendre que, à son avis, les petits Etats sont préférables, pour une part car ils rendent la démocratie plus facile à mettre en oeuvre. Quand il parle de démocratie, il veut dire, comme voulaient dire les Grecs, la participation directe de chaque citoyen. Le gouvernement représentatif, il appelle ça "une aristocratie élective". Etant donné que la démocratie [au sens qu'il lui donne] n'est pas possible dans un grand Etat, ses louanges pour la démocratie doivent être entendues comme des louanges pour la cité-Etat [Genève en étant une à l'époque de Rousseau]. Cet amour de la cité-Etat n'est, à mon sens, par suffisamment souligné dans les divers comptes-rendus, qui ont été faits par des commentateurs, de la philosophie politique de Rousseau.
Bien que le livre soit beaucoup moins rhétorique que la plupart des autres écrits de Rousseau, le premier chapitre s'ouvre sur un puissant morceau de rhétorique : "L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question."
La liberté est le but nominal de la pensée de Rousseau, mais en fait c'est l'égalité à laquelle il attache de la valeur [plus qu'à la liberté]. Et il cherche à assurer l'égalité aux dépens au besoin de la liberté.
La conception du Contrat social de Rousseau semble, à première vue, analogue à celle de Locke, mais rapidement il se révèle plus proche de Hobbes [qui recommandait que le peuple donne le pouvoir à une instance, soit un roi, soit une assemblée représentative, préférablement un roi]. Dans l'évolution depuis l'Etat de nature, il arrive un moment où les individus ne peuvent plus se maintenir eux-mêmes dans l'indépendance primitive ; il devient alors nécessaire à la self-préservation qu'ils s'unissent pour former une société. Mais comment puis-je confier ma liberté sans faire de tort à mes intérêts ? "Le problème est de trouver une forme d'association qui défendra et protégera, avec toute la force résultant de l'union, la personne et les biens de chaque associé, et dans laquelle chacun, tout en étant uni à tous les autres, pourra n'obéir qu'à lui-même, et rester aussi libre qu'avant. C'est le problème fondamental auquel le Contrat social apporte la solution."
La Contrat social consiste en la "totale acceptation par chaque associé de confier la défense de sa personne et de ses biens à l'ensemble de la communauté ; car, dès le départ, comme chacun se donne entièrement et absolument, les conditions sont les mêmes pour tous ; et par conséquent personne n'a intérêt à en faire un fardeau pour les autres". Cette aliénation doit être sans réserve : "Si les individus conservaient certains droits, comme il n'y aurait pas de supérieur commun pour décider entre eux et le bien public, chacun, étant sur un point son propre juge, demanderait à l'être aussi sur tous ; l'état de nature alors continuerait, et l'association deviendrait nécessairement inopérante ou tyrannique."
[Ce sont encore une fois de ces plans qui d'une part sont simplistes comme la ville de Babar en Afrique, ou de Platon en Sicile, ou de Plotin en Campagnie, ou des urbanistes modernes dans les quartiers nord de Marseille, mais en outre ignorent tout de la sociologie et de la mécanique sociale.
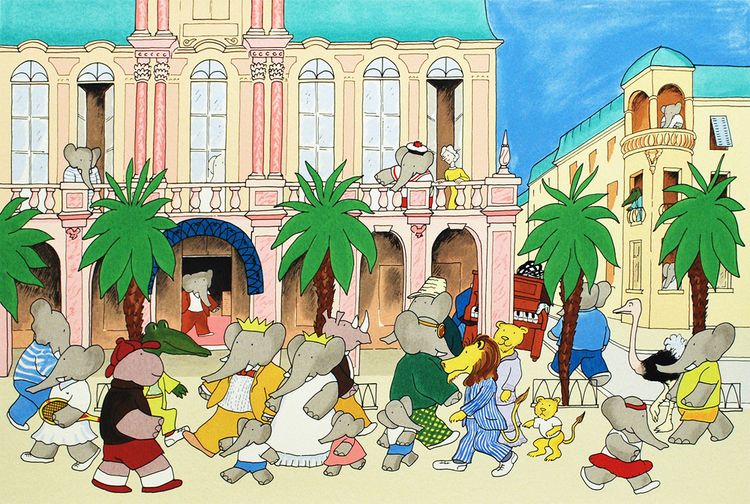
Célesteville en Afrique, lire un commentaire bienveillant d'un critique contemporain en 2018, et moins bienveillant de moi en 2003
Je l'ai déjà dit et je le répète : on peut dessiner sur le papier une machine, faite de nombreuses tiges et roues dentées, très élaborée, qui devrait apparemment marcher très bien, mais qui, cependant, se coince dès son lancement, car la répartition et transmission des forces par les différents éléments ne conduisent pas à un fonctionnement mécanique possible dans la réalité.
Ca a été malheureusement le cas du communisme soviétique, très inspiré de Rousseau. Et c'est malheureusement le cas aussi du communisme chinois.]
Ceci implique une complète abrogation de la liberté et une complete rejection de la doctrine des droits de l'homme. Il est vrai que, dans un chapitre ultérieur, cette théorie est un peu édulcorée. Il y est dit que, bien que le contrat social donne au corps politique le pouvoir absolu sur ses membres, néanmoins les êtres humains ont des droits naturels en tant qu'hommes. "Le souverain ne peut pas imposer à ses sujets des chaînes qui soient inutiles pour la communauté, et il ne peut même pas le souhaiter." Mais le souverain est le seul juge de ce qui est utile ou inutile pour la communauté. Il est clair qu'un obstacle seulement très faible est ainsi opposé à la tyrannie collective.
Il convient de noter que "le souverain" désigne, chez Rousseau, non le monarque ou le gouvernement, mais la communauté dans ses capacités collectives et législatives.
Le Contrat social peut être énoncé de la manière suivante : "Chacun de nous met sa propre personne et tous ses pouvoirs en commun sous la direction suprême de la volonté générale, et, dans notre capacité ainsi incorporée, nous recevons chaque membre comme une part indivisible du tout." Cet acte d'association crée un corps moral et collectif, qui est appelé l' "Etat" quand il est passif, le "Souverain" quand il est actif, et un "Pouvoir" dans ses relations avec les autres corps constitués comme lui.
La conception de la "volonté générale", qui apparaît dans la formulation ci-dessus du Contrat, joue un rôle très important dans le système de Rousseau. Je vais en dire plus dans quelques instants.
Il est dit que le Souverain n'a pas besoin de donner des garanties à ses sujets, car, puisqu'il est formé des individus qui le composent, il n'a aucun intérêt contraire à ceux de ses sujets.
[On a là une base théorique fantaisiste pour la tyrannie communiste, ce qu'on a appelé aussi l'Etat totalitaire.]
"Le Souverain, par la simple vertu de ce qu'il est, est toujours ce qu'il doit être." Cette doctrine est trompeuse pour le lecteur qui n'observerait pas l'usage un peu particulier que Rousseau fait des mots. Le Souverain n'est pas le gouvernement, qui, Rousseau l'admet, peut être tyrannique ; le Souverain est une entité plus ou moins métaphysique [R. utilise le mot métaphysique comme un client du café du commerce], qui n'est pas totalement incorporée dans un quelconque organe de l'Etat. Son infaillibilité, par conséquent, même si on l'admet, n'a pas les conséquences pratiques qu'on pourrait penser qu'elle a.
[Bin, non. Dans la mesure où c'est une création doctrinale imaginaire -- le peuple souverain -- la représentation de cette entité par un pouvoir concret est laissée à la portée et à la merci des plus forts, par exemple les "Bolcheviks" (ce qui veut dire les Majoritaires, et qui se nommaient eux-mêmes ainsi pour cacher le fait qu'ils étaient en réalité minoritaires).]
La volonté du Souverain, qui a toujours raison, est la "volonté générale". Chaque citoyen, qud citoyen, prend part à la volonté générale, mais il peut aussi, en tant qu'individu, avoir une volonté particulière qui va l'encontre de la volonté générale. Le Contrat Social prévoit que quiconque refuse de se plier à la volonté générale sera contraint de le faire. "Cela ne signifie pas moins qu'il sera forcé d'être libre."
[On commence à entendre l'écho des discours délirants de la Pravda, et du régime communiste soviétique des années 30 et 40 sur la supériorité du matérialisme dialectique pour accéder à la vérité -- même en science.
Curieusement, dans cette formule "être forcé d'être libre", on entend aussi des échos sartriens...]
Cette conception où l'individu est "forcé d'être libre" est très métaphysique.
[Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un exemple de torture des mots, comme s'en sont fait une spécialité la religion catholique, les scolastiques, les communistes, et tous les systèmes totalitaires et orwelliens de la terre.]
La volonté générale à l'époque de Galilée était certainement anti-copernicienne ; Galilée a-t-il était "forcé d'être libre" quand l'Inquisition l'a contraint à se rétracter ? Un malfaiteur est-il "forcé d'être libre" quand il est jeté en prison ? Pensons au Corsaire de Byron :
O'er the glad waters of the deep blue sea, Our thoughts as boundless and our hearts as free.
Cet homme serait-il plus "libre" dans un donjon ? La chose bizarre est que les nobles pirates de Byron sont le produit direct de Rousseau, et cependant dans le passage ci-dessus, Rousseau oublie son romantisme et parle comme un policier qui aurait du vocabulaire [comme Hegel]. Hegel, qui doit beaucoup à Rousseau, adopta cet usage tordu du mot "liberté", et le définit comme le droit d'obéir à la police, ou quelque chose comme ça.
Attitude par rapport à la propriété privée (moins attaché que Locke)
Rousseau n'a pas le profond respect pour la propriété privée qui caractérise Locke et ses disciples. "L'Etat, dans la relation avec ses membres, est le maître de tous leurs biens." Il ne croit pas non plus à la séparation des pouvoirs, telle que prêchée par Locke et Montesquieu. A cet égard, cependant, comme à d'autres, les discussions ultérieures plus détaillées dans lesquelles il se lance ne sont pas en parfait accord avec les principes généraux qu'il a énoncés préalablement.
Dans le Livre III, Chapitre 1, il dit que la part du Souverain se limite à faire les lois, et que l'exécutif, ou gouvernement, est un corps intermédiaire placé entre les sujets et le Souverain pour s'assurer de leur correspondance mutuelle.
["correspondance mutuelle" est énigmatique, mais comme la "pensée" de Rousseau est à une vraie pensée politique ce que la dinette est à un vrai repas, ce n'est pas important de comprendre précisément ce que Rousseau veut dire].
Il poursuit en disant : "Si le Souverain désire gouverner, ou si les magistrats désirent faire les lois, ou si les sujets refusent d'obéir, le désordre s'installe à la place de la régularité, et... l'Etat tombe dans la tyrannie ou l'anarchie." Avec cette phrase, prenant en compte la différence de vocabulaire, Rousseau semble d'accord avec Montesquieu.
Doctrine de la volonté générale
Je viens maintenant à la doctrine de la volonté générale, qui est à la fois importante et obscure. La volonté générale n'est pas identique à la volonté de la majorité, ni même à la volonté de tous les citoyens. Elle semble conçue comme étant la volonté appartenant au corps politique en tant que tel. Si nous adoptons la vue de Hobbes, selon laquelle la société civile est une personne, nous devons supposer qu'elle est dotée des attributs d'une personne, y compris la volonté. Mais nous sommes alors confrontés à la difficulté de décider quelles sont les manifestations visibles de cette volonté, et ici Rousseau nous laisse dans le noir. On nous dit que la volonté générale aura toujours raison [au sens de "être juste et raisonnable"], et poussera toujours au bien public ; mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple soient toujours elles aussi correctes, car il y a souvent une grande différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Comme, alors, pouvons-nous connaître ce qu'est la volonté générale ? Il y a, dans le même chapitre, une sorte de réponse :
"Si, quand le peuple, informé correctement, tient ses délibérations, les citoyens n'ont aucun moyen de communiquer entre eux, la somme de toutes les petites différences produira la volonté générale, et la décision sera toujours la bonne."
[Rousseau, comme tous les gourous, orateurs, et non-mathématiciens, utilise des modèles mathématiques implicites fantaisistes, sinon fantastiques.]
La conception, dans l'esprit de Rousseau, semble être ceci : l'opinion politique de chaque homme est gouvernée par son intérêt personnel, mais l'intérêt personnel a deux parties, une qui est spécifique à l'individu en question, tandis que l'autre est commune à tous les membres de la communauté. Si les citoyens n'ont pas la possibilité de se lancer dans des négociations de sous-groupes, leurs intérêts personnels, étant divergents, s'annuleront, et il en résultera ce qui représente leur intérêt commun ; cette résultante est la volonté générale. Peut-être la conception de Rousseau est illustrée par la gravitation terrestre. Chaque particule formant la terre attire toutes les autres particules dans l'univers vers elle ; l'air au-dessus de nous nous attire vers le haut, tandis que la terre nous attire vers le bas. Mais toutes ces attractions "égoïstes" se compensent les unes les autres, car elles sont divergentes, et ce qui reste est l'attraction résultante vers le centre de la terre.
[Russell connaît ou ne connaît pas le théorème de Newton selon lequel, une particule à l'intérieur d'une sphère homogène (ou en tout cas où où la densité locale à un point P ne dépend que de la longueur du rayon OP où O est le centre) , n'est soumise qu'à l'attraction de ce qui est plus près du centre qu'elle. Tout ce qui est plus distant du centre a un effet total nul sur la particule. C'est un théorème un peu difficile que Newton a mis plusieurs années à résoudre. Maintenant, avec la technique mathématique adéquate, cela prend quelques lignes.]
Cela est peut-être un conception extravagante de considérer l'action de la terre comme celle d'une communauté, et comme l'expression de la volonté générale.
Dire que la volonté générale a toujours raison revient seulement à dire que, puisqu'elle représente ce qui est commun à tous les intérêts particuliers de chaque citoyen, elle doit représenter la plus grande satisfaction collective ou intérêt égoïste "collectif" de la communauté. Cette interprétation de ce que veut dire Rousseau semble en accord avec ce qu'il écrit davantage de toute autre interprétation à laquelle j'ai été capable de penser. (Par exemple, "Il y a souvent une grande différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; la seconde ne tient compte que des intérêts communs ; la première regarde aussi les intérêts particuliers, et n'est que la somme des volontés particulières ; mais enlevez de ces volontés le plus et le moins qui vont s'annuler, et la volonté générale est ce qui restera comme somme des différences." [Même commentaire: le "modèle mathématique" sous-jacent n'a ni queue ni tête.])
D'après Rousseau, ce qui interfère avec la pratique de cette expression de la volonté générale est l'existence d'associations formant des sous-groupes au sein de l'Etat.
[Là Rousseau n'a pas tort : les groupes d'intérêt privé, les lobbies, certaines organisations franc-maçonnes, ou équivalent, travaillent à l'encontre de l'intérêt général.]
Chacune aura sa propre volonté générale, qui peut entrer en conflit avec celle de la communauté dans son ensemble. "On peut dire qu'il n'y a plus autant de vote que de citoyens votant, mais seulement autant que d'associations." Cela a une conséquence importante : "Il est donc essentiel, si la volonté générale doit être capable de s'exprimer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sociétés partielles [de sous-groupes] au sein de l'Etat, et que chaque citoyen puisse penser par lui-même : ce qui était justement l'unique et sublime système établi par le grand Lycurgue." Dans une note de bas de page, Rousseau en appelle à l'autorité de Machiavel pour étayer son point de vue.
[On notera que dans le monde contemporain, en 2020, non seulement les sous-groupes de pression ou d'intérêts particuliers faussent le jeu démocratique, mais il y a un nouveau problème encore plus difficile créé par les réseaux sociaux : la possibilité pour un groupe d'intérêt particulier en influençant les membres d'un réseau social, ou en diffusant de fausses informations, de distordre une élection.
C'est un problème en partie politique, en partie mathématique, sur lequel il faudra faire des progrès.]
Considérez ce qu'un tel système impliquerait en pratique. L'Etat devrait prohiber les églises (sauf l'Eglise d'Etat), les partis politiques, les syndicats professionnels, ouvriers et autres, et toutes les autres organisations d'hommes ayant des intérêts communs.
[C'est à nouveau Célesteville !]
Le résultat serait manifestement un Etat corporatiste ou totalitaire, dans lequel l'individu citoyen n'aurait aucun pouvoir. Rousseau semble réaliser qu'il serait difficile d'interdire toutes les associations, et ajoute, comme une pensée lui venant après coup, que, s'il doit y avoir des sous-groupes organisés, alors plus il y en a mieux c'est, afin qu'ils se neutralisent les uns les autres.
[On se demande pourquoi on prête tant d'attention à la dinette d'un gars qui a écrit ses élucubrations il y a près de trois siècles. Si c'était quelqu'un écrivant aujourd'hui, un sorte d'Edgar Morin graphomane, on n'y prêterait pas plus d'attention. Mais Rousseau a engendré les doctrines totalitaires qui ont créé des malheurs terribles sur une bonne partie de la planète pendant des décennies.
Noter cependant ce que R. disait au début du chapitre introductif sur le libéralisme : l'influence des penseurs sur les politiques ne doit pas être surestimée. Souvent les politiques qui se réclament de tel ou tel penseur, n'ont fait que choisir le penseur qui se trouve avoir dit des choses allant dans leur sens.]
Quand, dans plus loin dans son livre, Rousseau en arrive à considérer le gouvernement, il réalise que l'exécutif est inévitablement une association ayant un intérêt et une volonté générale qui lui sont propres, et qui peuvent aisément entrer en conflit avec ceux de la communauté dans son ensemble. Il dit que tant que le gouvernement d'un grand Etat doit être plus fort que celui d'un petit, il n'est pas nécessaire de restreindre l'action du gouvernement à l'aide du Souverain. Un membre du gouvernement à trois volontés : sa volonté personnelle, celle du gouvernement, et la volonté générale. Ces trois volontés devraient former une sorte de crescendo [chaque suivante plus importante que la précédente], mais dans la réalité c'est souvent plutôt un diminuendo. Encore un fois : "Tout conspire à retirer à un homme, qui a reçu de ses concitoyens l'exercice de l'autorité, le sens de la justice et de la raison."
Conclusions sur l'ouvrage "Le Contrat social" et sur le concept de Volonté générale
Ainsi, en dépit de l'infaillibilité de la volonté générale, qui est "toujours constante, inaltérable et pure", les vieux problèmes d'éviter la tyrannie sont toujours là. Ce que Rousseau a à dire sur ces problèmes est soit un discret plagiat de Montesquieu, soit une insistance sur la suprématie de la législature, qui, si elle est démocratique, est identique avec ce qu'il appelle le Souverain. Les grands principes généraux avec lesquels il démarre, et qu'il présente comme ayant résolu les problèmes politiques, disparaissent quand il condescend à entrer dans des considérations détaillées, auxquelles ses principes n'apportent aucune solution.
La condamnation du livre par les réactionnaires contemporains de Rousseau pourrait conduire le lecteur moderne à s'attendre à trouver dedans une doctrine bien plus révolutionnaire que ce que l'ouvrage contient en réalité.
Nous pouvons illustrer ceci par ce qui est dit de la démocratie. Quand Rousseau utilise ce mot, il veut dire, comme nous venons de le voir, la démocratie directe comme dans les cités-Etats de l'Antiquité. Cela, souligne-t-il, ne peut jamais être complètement mis en oeuvre, parce que les gens ne peuvent jamais être tous rassemblés pour prendre des décisions sur les affaires publiques. "S'il y avait un peuple composé de dieux, son gouvernement serait démocratique. Mais un gouvernement parfait n'est pas pour les hommes."
Ce que nous nous appelons démocratie, lui l'appelle aristocratie élective ; cela, dit-il, est le meilleur des gouvernements, mais n'est pas adapté à tous les pays. Le climat ne doit être ni trop chaud ni trop froid ; la production ne doit pas excéder ce qui est nécessaire [à la consommation ?], car, quand ça l'excède, les maux du luxe deviennent inévitables, et il est préférable que ces maux soient limités au monarque et à sa cour plutôt que répandus dans toute la population. [On atteint carrément au risible dans la "pensée" de Rousseau.]
Grâce à ces limitations, un grand champ est laissé pour un gouvernement despotique. Néanmoins son soutien à la démocratie, malgré ses limitations, fut certainement l'une des choses qui suscita l'hostilité implacable du gouvernement français envers son livre ; l'autre, vraisemblablement, était le rejet par Rousseau du droit divin des rois, qui est une conséquence implicite sur Contrat social comme origine du gouvernement.
Le Contrat social devint la Bible de presque tous les leaders de la Révolution française, mais il ne fait pas de doute, comme c'est le destin de toutes les Bibles, qu'il ne fut pas lu avec soin, et encore moins compris par ses disciples.
Il réintroduisit l'habitude des abstractions métaphysiques chez les théoriciens de la démocratie.
Et par sa doctrine de la volonté générale il rendit possible une identification quasi mystique d'un leader avec son peuple, sans avoir besoin d'une confirmation avec un instrument aussi vulgaire qu'une urne électorale.
Une grande partie de la philosophie de Rousseau sera reprise par Hegel. Hegel sélectionnera pour des louanges particulières la distinction entre volonté générale et volonté de tous. Hegel, pour sa défense de l'autocratie prussienne, dit : "Rousseau aurait fait une contribution plus solide à la théorie de l'Etat, s'il avait toujours conservé cette distinction à l'esprit." extrait de Logique, Sec. 163.
Le premier fruit en pratique de la doctrine de Rousseau fut le règne de Robespierre. Les dictatures en Russie et en Allemagne (tout particulièrement cette dernière) font partie des retombées des enseignements de Rousseau.
Quels futurs triomphes l'avenir réserve-t-il à son fantôme, je ne m'avancerai pas à le prédire.